D’où la Suisse tire ses écrivains

«Ce que les jeunes écrivains – et surtout écrivaines – suisses produisent n’a jamais été d’une telle qualité». Ce fut la conclusion de l’écrivain Peter Bichsel aux dernières Journées littéraires de Soleure. Une des raisons en est peut-être le nouveau centre de formation de Bienne.
Le cendrier devant la villa biennoise où est installé l’Institut littéraire suisseLien externe est encore vide. À l’intérieur, Regina DürigLien externe, professeure et autrice, accueille les étudiants de première année pour l’atelier d’écriture hebdomadaire en langue allemande. «Bonjour», s’exclame le dernier arrivant. Regina Dürig demande: «Et où sont les autres, est-ce que quelqu’un à une idée?» L’intimité des lieux et le tutoiement généralisé créent une ambiance qu’on s’attendrait à rencontrer au niveau primaire plutôt que dans une haute école.

L’institut propose l’unique cycle d’études en «écriture littéraire» des hautes écoles spécialisée de Suisse. Il est, comme la ville de BienneLien externe qui l’accueille, bilingue – la littérature y est produite en français ou en allemand. Aux États-Unis, des centaines de collèges offrent des formations dédiées à la création littéraire et en Grande-Bretagne il y a 162 programmes d’études de ce type au niveau du bachelor. En revanche, l’idée d’une formation académique à l’écriture est nettement moins répandue dans l’espace germanophone où il n’y a pas une dizaine de programmes pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse réunies. Dans l’espace francophone, à l’exception du Québec, aucune formation pratique à l’écriture littéraire n’existait lorsque l’Institut littéraire de Bienne s’est ouvert. Il a ainsi été le premier à dispenser cette formation en français sur le continent européen.
L’atelier. Les étudiants doivent effectuer l’exercice suivant: écrire en cinq minutes un texte commençant avec la phrase «Voici l’histoire que je n’ai jamais voulu te raconter quand j’étais ton amie». Elle vient de l’autrice et réalisatrice Miranda JulyLien externe, ce que les étudiants ignorent encore. Ils écrivent de manière très concentrée, mais sans stress. La professeure fait sonner un bol chantant. C’est le signe que les cinq minutes touchent à leur fin.

Les étudiants lisent ensuite leurs textes. L’un bascule dans la théorie littéraire. Un autre, dans la plus pure tradition beat, parle de cadavres de bouteilles dans une cuisine. Au passage, on écorche également la presse: que fait-elle ici alors qu’elle pourrait se pencher sur les conditions dans les prisons de Colombie? Les textes sont accueillis avec des sourires ou de brèves formules d’approbation. L’exercice doit permettre d’accumuler de la pratique – critique et analyse ne sont pas une priorité. C’est aux auteurs de décider s’ils donneront une suite à ces textes.
Les critiques abondent en revanche après la lecture de la nouvelle de Miranda July dont était tirée la première phrase. La fin surtout pose problème. «Je lui aurais conseillé de la couper si j’avais dû relire le manuscrit.»
Les étudiants paraissent aussi différents que les supports sur lesquels ils écrivent: blocs, carnets de notes – même les laptops sont personnalisés avec des stickers. Trois étudiants suivent ici leur première formation, mais d’autres ont derrière eux des parcours plus étoffés et il y a même un ingénieur en environnement qui veut devenir écrivain. Ils ne sortent pas tous de familles cultivées et, pour certains, ni le père ni la mère n’ont fait d’études.
Ce dernier point est intéressant parce que celui qui décide de se lancer dans la littérature en Suisse renonce implicitement à un revenu assuré. Alors que les formations théâtrales mises en place par l’État préparent au moins à des professions avec des contrats de travail fixe, le nombre des candidats y varie en fonction de la conjoncture économique. À Bienne en revanche, il reste constant et il y a chaque année une centaine de dossiers, indique la directrice de l’Institut Marie Caffari.
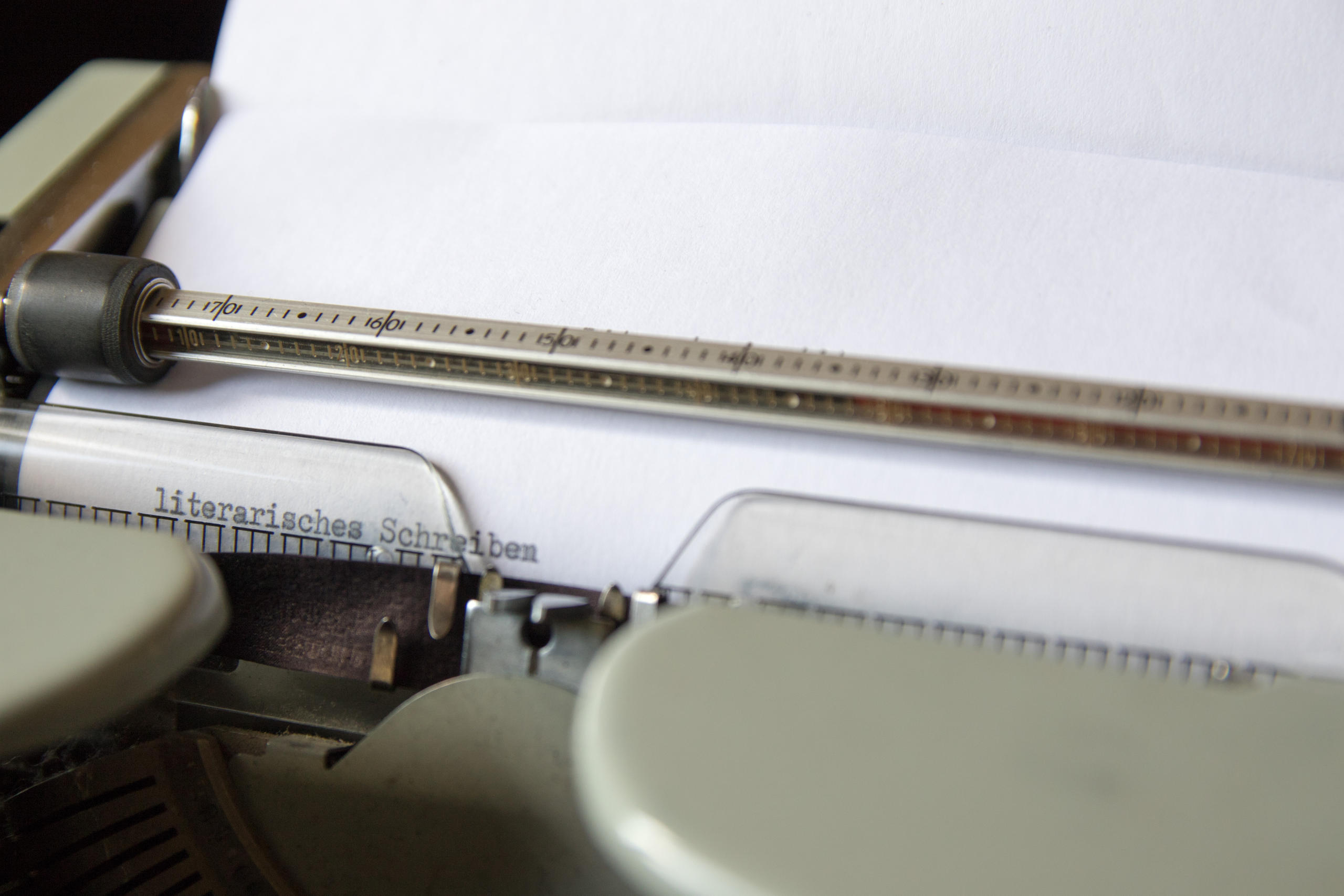
La haute école en sélectionne quinze. Lorsqu’elle a ouvert ses portes en 2006, il n’y avait parmi eux que deux francophones. Entretemps, le nombre de candidatures venant de Suisse romande, de France et de Belgique a progressé et la proportion d’étudiants francophones tourne maintenant autour de 30%. Marie Caffari s’en réjouit, mais elle souligne immédiatement que se limiter au français et à l’allemand ne correspond plus à la réalité: «Nous vivons dans une société plurilingue. Certains étudiants s’inspirent de la littérature anglo-saxonne qui influence très fortement leur écriture. D’autres ne sont pas de langue maternelle française ou allemande.» Le bilinguisme est trop étroit.
«Ils sont formés à une profession pour laquelle n’y a pas d’emplois»
Devant la villa de Bienne, le cendrier se remplit à la pause. Les étudiants expliquent qu’ils souhaiteraient avoir encore plus d’échanges avec leurs pendants francophones et se demandent s’ils changeront de mentor au terme de leur première année. Une grande partie des études n’a pas lieu dans les ateliers d’écriture ou les séminaires et ne suit pas une grille horaire. Elle est occupée par les projets individuels, les performances, les lectures et les publications. Sans compter le mentorat: tous les étudiants sont suivis par des mentors pendant leurs trois ans à l’institut. Pour la première année, ce sont les mentors qui choisissent leurs mentorés. Mais ensuite, les étudiants sont invités à en changer afin d’obtenir des perspectives et un input différents.
Jusqu’à présent, 110 personnes ont obtenu un Bachelor of Arts en écriture littéraire à Bienne. Parmi elles figurent notamment Arno CamenischLien externe, Michelle SteinbeckLien externe et Dorothee ElmigerLien externe qui sont maintenant des romanciers ou romancières reconnus. Mais tous les diplômés n’écrivent pas des romans et tous les romanciers ne parviennent pas à vivre de leur plume. Comment les auteurs titulaires d’un bachelor gagnent-ils leur pain?

Marie Caffari compare leur situation à celles des étudiants qui sortent d’une haute école de jazz: «Une fois qu’ils ont développé leur propre praxis, ils sont en mesure de s’établir dans le milieu littéraire». Ils savent à quoi ils s’intéressent et ils disposent d’un réseau adéquat. La directrice décrit cela comme «la situation particulière de la formation à une profession pour laquelle n’y a pas d’emplois».
Certains vivent aujourd’hui de leurs textes – de lectures et de la vente des ouvrages. D’autres sont devenus performeurs publics ou se consacrent au «spoken word» et sont accompagnés par des musiciens. Il y en même qui ont créé leur propre métier, comme Julia Weber et son service littéraire. Elle travaille sur mandat et peut par exemple établir le protocole littéraire d’un événement, que ce soit un anniversaire privé ou un festival de danse.
Son premier texte de ce genre lui est venu en atelier d’écriture. «Au début, je n’avais pas envie de lire devant les autres. Mais j’ai peu à peu remarqué que j’aimais l’écriture spontanée.» Elle a réalisé qu’elle était capable d’écrire très rapidement un texte dont les autres pouvaient tirer quelque chose. Peut-être que les étudiants actuels découvriront eux aussi leur propre mode d’expression à l’aide des mots qu’ils griffonnent avant que le bol chantant ne résonne. D’ailleurs, ils n’ont pas à se limiter à une seule solution: ainsi, au début de 2017, Julia WeberLien externe a publié son premier roman «Immer ist alles schön» et il a déjà été primé à l’étranger. Est-ce qu’il existerait si elle n’avait pas étudié à l’Institut suisse de littérature? «Oui, mais sous un autre titre et ce ne serait pas le même livre», dit-elle.
(Traduction de l’allemand: Olivier Hüther)

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative













Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.