Koyo Kouoh: l’art est dans les fissures, pas dans le vernis

Le Prix Meret OppenheimLien externe a pris Koyo Kouoh par surprise, et pas uniquement parce qu’elle n’est pas intéressée par les prix. La commissaire d’exposition helvético-camerounaise dit n’avoir jamais trouvé en Suisse un écho fort pour ses sujets artistiques – le post-colonialisme, la diaspora africaine et la politique identitaire – pour lesquels elle a reçu des éloges dans de nombreux autres pays.
Koyo Kouoh, que le New York Times désignait en 2015 comme «l’un des plus importants conservateurs d’art d’Afrique», est toujours en mouvement, même en pleine pandémie. Elle vit actuellement au Cap, en Afrique du Sud, où elle dirige le Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (MOCAA), qui abrite la plus grande collection d’art contemporain au monde.
Nous l’avons rencontrée lors d’un court séjour en Suisse. Son mari vit à Bâle, mais son cœur est à Zurich, dit-elle, même si elle essaie actuellement de rentrer en Afrique du Sud (mais est encore bloquée en Suisse).
Née en 1967 dans la ville côtière de Douala au Cameroun, Koyo Kouoh est venue à Zurich au début de son adolescence pour retrouver sa mère. Elle a suivi une formation bancaire et commerciale avant de se tourner vers les arts.
swissinfo.ch: Comment avez-vous vécu le transfert de votre vie du Cameroun en Suisse?
Koyo Kouoh: Je suis née à Douala, où la vivacité, l’activité, le bruit de la vie urbaine étaient très forts. Ainsi, en venant à Zurich, je l’ai trouvée extrêmement calme, petite, propre; tout ce qui est caractéristique de la Suisse. Pour moi, ce fut un voyage émotionnel, extrêmement enrichissant de pouvoir vivre à nouveau avec ma mère et d’apprendre une nouvelle langue, le suisse allemand, que j’ai toujours voulu apprendre. Le Cameroun était une colonie allemande jusqu’à la Première Guerre mondiale et de nombreux mots allemands sont encore présents dans notre dialecte local.
Votre intérêt pour l’art a-t-il mûri depuis longtemps ou est-il le fruit du hasard?
Les gens sont faits de nombreux «tissus», il y en a un pour la créativité et pour les arts, ou pas. Je suis contre l’idée que ce n’est que dans certains contextes ou avec une certaine éducation que l’on a accès à des idées créatives ou artistiques. Je viens d’un contexte très modeste; ma grand-mère était couturière. On ne peut pas grandir en Afrique sans avoir accès à la créativité. La danse, la musique, les vêtements sont partout. Vous n’avez pas besoin d’une école particulière, cela fait partie du mode de vie.

Plus
Zurich vue par Koyo Kouoh
En 2014, vous aviez présenté une proposition en vue de la biennale Manifesta 11 à Zurich deux ans plus tard. Votre proposition a été refusée, mais elle a provoqué pas mal de réactions au sein de la scène artistique locale. Quels étaient les principaux thèmes que vous vouliez aborder avec elle?
Je n’ai jamais porté de candidature pour aucune de ces biennales, mais dans ce cas, j’avais reçu une demande de leur part. À l’époque, je réfléchissais aussi par mal au circuit des biennales d’art, au spectacle qu’elles produisent et au marketing qu’elles génèrent dans les villes qui les accueillent.
Même si ma proposition n’a pas été retenue, je l’ai quand même appréciée, car je pense qu’elle mettait en lumière des aspects historiques que très peu de gens connaissent de Zurich.
Et que faut-il savoir sur Zurich?
C’est un endroit si petit, mais si plein de culture, si plein de richesse. Je voulais vraiment regarder les fissures plutôt que le vernis. C’est quelque chose qui aurait infiltré la ville, au lieu de l’exposer avec de belles vues.
En pensant à cette proposition, j’ai estimé que Zurich était un endroit qui n’avait pas besoin d’une nouvelle biennale d’art contemporain, mais d’un nouveau dialogue. Et à l’époque, la Suisse était totalement empêtrée dans des discussions sur le racisme, sur les controverses de l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice), sur la limitation de l’immigration. Autant de discussions qui restent d’actualité.
Ce serait vraiment bien de lier Zurich et la Suisse aux plus grands récits du XXe siècle: postcolonialisme, postmodernité, migration, racisme, colonialisme sous ses nombreuses formes.
Après ce refus, l’attribution du Prix Meret Oppenheim a-t-elle été une surprise pour vous?
Une surprise totale. Je n’ai jamais travaillé en Suisse en tant que conservatrice ou productrice culturelle. J’ai quitté la Suisse pour le Sénégal il y a exactement 24 ans: tout mon parcours professionnel s’est fait ailleurs qu’ici.
J’ai passé ma jeunesse ici et j’ai un bon souvenir de cette époque. Je ne savais pas que l’Office fédéral de la culture à Berne me suivait d’une quelconque manière, pour la simple raison que les thèmes qui m’intéressent, les idées que je porte dans mon travail – diaspora africaine, art conceptuel basé sur les processus, post-colonialisme, politique d’identité – ne sont pas exactement populaires ici. Je n’ai pas eu l’occasion de travailler dans ce pays dans ces domaines, mais cela me convient. Je ne vois pas la Suisse comme un lieu de travail potentiel.
Que reste-t-il de vos liens avec la Suisse?
C’est une question d’émotion. J’aime le pays, j’ai un passeport suisse, ma famille est ici et, il y a trois ans, j’ai reçu pour la première fois une invitation de Pro Helvetia à organiser le Salon Suisse [un espace parallèle à l’exposition du Pavillon suisse officiel pour la Biennale de Venise]. Mais je ne pense jamais aux prix. Je fais ce que j’ai à faire.
Vous arrive-t-il de penser à la figure de Meret Oppenheim, à celle de l’artiste?
Bien sûr! Quand j’ai commencé à m’intéresser à l’art, le mouvement surréaliste était une référence évidente, l’héritage de Dada était très présent, donc évidemment Meret Oppenheim était une figure. Aussi parce qu’elle était une femme et qu’à cette époque, avoir une voix ou une position, surtout parmi tous ces surréalistes super machos, comme André Breton, était un bon résultat pour une femme d’un si petit pays. De plus, le féminisme est pour moi ma première nature. Je suis très impliquée dans la voix des femmes, mais je ne fais pas beaucoup de bruit autour. Je n’ai pas besoin de porter un drapeau, cela me vient naturellement.

La Suisse a une étrange relation avec le modernisme. Bien que le Dada a débuté à Zurich, le mouvement est encore très timidement enseigné dans les écoles.
Dans les années 1980, l’esprit du Cabaret Voltaire a été relancé d’une certaine manière. Mais nous devons considérer qu’il y a un haut niveau de spécialisation dans la culture suisse, une spécialisation dans tout. Regardez comment l’éducation est structurée en Suisse. Les gens sont piégés très tôt dans différents domaines et n’ont pas accès aux connaissances dans d’autres domaines. Contrairement à des endroits comme le Cameroun ou le Brésil, ou d’autres régions post-coloniales, où les gens ont tendance à avoir un savoir pan-social et généraliste, où ils savent et apprennent différentes choses. Ici, on sait beaucoup sur une chose, principalement.
La Suisse présente également un grand complexe d’infériorité, en termes de taille et d’autonomie. Il n’y a pas de véritable uniformité dans le pays, on y parle allemand, français, italien. J’ai observé au fil des ans que c’est un pays qui aime se tenir sur le trottoir et fournir l’asphalte pour paver la route – et gagner de l’argent en le faisant. On le voit aussi quand on regarde les études coloniales et l’histoire coloniale: la Suisse dit toujours «Nous avons été neutres, nous n’avons pas été impérialistes, nous n’avons jamais participé à tout cela». Bien sûr que si! Jusqu’à aujourd’hui. N’oubliez pas que le plus grand marché pour les matières premières est Zoug, par exemple.
Une nouvelle génération d’historiens suisses a travaillé ces dernières années pour dévoiler le passé et le présent colonial de la Suisse. Mais il n’a pas encore atteint les écoles.
Il faudra un certain temps pour atteindre les écoles. Le bon et le mauvais côté de ce pays est que tout va très lentement. C’est mauvais quand on est pressé. La lenteur a ses avantages, mais à l’époque où nous vivons, les choses devraient être plus rapides. Toute cette conversation doit atteindre les familles. Car il y a encore beaucoup de Suisses qui vivent ces mythes sur le pays, qui n’ont pas un pied dans l’histoire. Toutes ces mythologies doivent être détruites. Cela ne doit en aucun cas faire honte au pays. Il s’agit d’offrir un tableau complet.
Traduzione di Armando Mombelli

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative


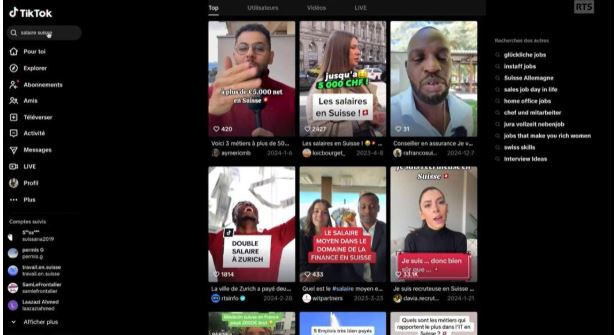










Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.