La guerre Iran-Irak vue par le cinéma iranien

Pour sa 20e édition, le Festival international de films de Fribourg (FIFF) consacre l'un de ses panoramas au cinéma de guerre iranien.
Un cinéma qui remplit les salles en Iran, mais qui reste largement méconnu en Occident.
Le 22 septembre 1980, Saddam Hussein profite du chaos qui règne en Iran après la révolution islamique et la chute du Shah pour envahir le pays. Ce sera le début de la guerre Iran-Irak qui va durer huit ans.
En Iran, cette guerre va être utilisée par les dirigeants pour tenter de redonner au pays une identité et une cohésion nationale. Dans ce contexte, le cinéma servira de vecteur pour justifier la guerre, ses victimes et ses défaites, auprès de la population.
C’est ce cinéma qui est présenté au FIFF dans le cadre du panorama «Le cinéma iranien s’en va-t-en guerre». Dans un premier temps, la direction du Festival de Fribourg, qui a fait appel à Agnès Devictor, spécialiste de cinéma iranien, songeait à une programmation consacrée aux femmes…
Succès en Iran
«Je leur ai dit: non, ça fait des années qu’on parle des femmes et du cinéma. C’est une programmation qui en devient gênante tellement elle est instrumentalisée, explique Agnès Devictor. J’ai proposé de faire quelque chose autour de la guerre Iran-Irak.»
«Cette guerre a été abondamment mise scène en Iran. Mais c’est une production qui est méconnue en Occident. Il faut dire que ces films ne sont pas tous des chefs-d’œuvre. Ils sont davantage dans le discours explicite que dans des effets cinématographiques.»
Peu connus ici, ces films sont en revanche massivement vus en Iran. «Ce sujet a intéressé le public iranien, pendant le conflit, mais aussi par la suite. En 1996, par exemple, c’est une comédie consacrée à la guerre Iran-Irak qui a enregistré les meilleures ventes de l’année.»
Un choix restreint
Bien sûr, il faut relativiser, ajoute Agnès Devictor, parce que le 98% des films projetés sur les écrans iraniens sont des productions nationales.
Des films qui disent parfois ce qui ne doit pas être dit… En d’autres mots, des bombes contre le gouvernement qui parviennent à échapper à la censure, «parfois par accident, parce que l’Etat ne s’y attend pas».
«Ce qui est intéressant, poursuit cette spécialiste du cinéma iranien, c’est que l’énorme majorité de ces films sont produits par des institutions qui dépendent du gouvernement.»
Etonnant? «Non, pas vraiment, parce que les producteurs privés ne prendraient jamais le risque d’investir dans un film qui pourrait ensuite être censuré».
Mise en scène singulière
A Fribourg, le spectateur occidental qui découvre ces films de guerre iraniens est sans doute surpris par la singularité de la mise en scène du conflit.
«Chez nous, les films de fiction sur la guerre présentent souvent une image assez édulcorée du conflit, commente Agnès Devictor. On évite de montrer les morts de son propre camp et les atrocités de la guerre. Ce qui n’est pas le cas en Iran.»
L’autre particularité du cinéma de guerre iranien, c’est sa précocité. Le premier film de fiction est sorti au début de la guerre. «Un phénomène rare dans l’histoire du cinéma», observe la curatrice du panorama.
La guerre comme paravent
Et 17 ans après la fin du conflit, les réalisateurs continuent de se servir de la guerre Iran-Irak, parfois pour traiter d’autres sujets qui, eux, sont tabous. C’est le cas notamment de «Motevaled-e Mah-e Mehr» (Né sous le signe de la liberté) d’Ahmad Reza Darvish.
Sorti en 2000, ce film évoque la guerre Iran-Irak, mais il relate surtout les grandes manifestations étudiantes de 1999. Longtemps écarté des écrans, parce qu’il était le foyer de la contestation, le milieu universitaire revient ainsi dans les salles de cinéma.
«Je l’ai vu en juillet 2000 à Téhéran, se souvient Agnès Devictor. Il a eu un énorme succès. Sa sortie a notamment été rendue possible parce que Darvish, qui est un grand réalisateur de films de guerre, s’en sert ici probablement comme paravent.»
swissinfo, Alexandra Richard à Fribourg
20e édition du Festival international de films de Fribourg (FIFF): 12-19 mars 2006
10 longs métrages (dont un film philippin de près de huit heures) et 9 documentaires en compétition
3 panoramas: le cinéma iranien et la guerre, le cinéma philippin numérique et un hommage à l’actrice brésilienne Helena Ignez
Agnès Devictor est maître de conférence à l’Université d’Avignon pour le département des sciences de l’information et de la communication.
Spécialiste du cinéma iranien, elle a collaboré à la programmation de plusieurs festivals européens.
Elle a travaillé pour la rubrique cinéma du journal «Le Monde» et pour «Les Cahiers du Cinéma».
Agnès Devictor a publié plusieurs ouvrages dont «Politique du cinéma iranien» (Editions du CNRS, 2004).

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative


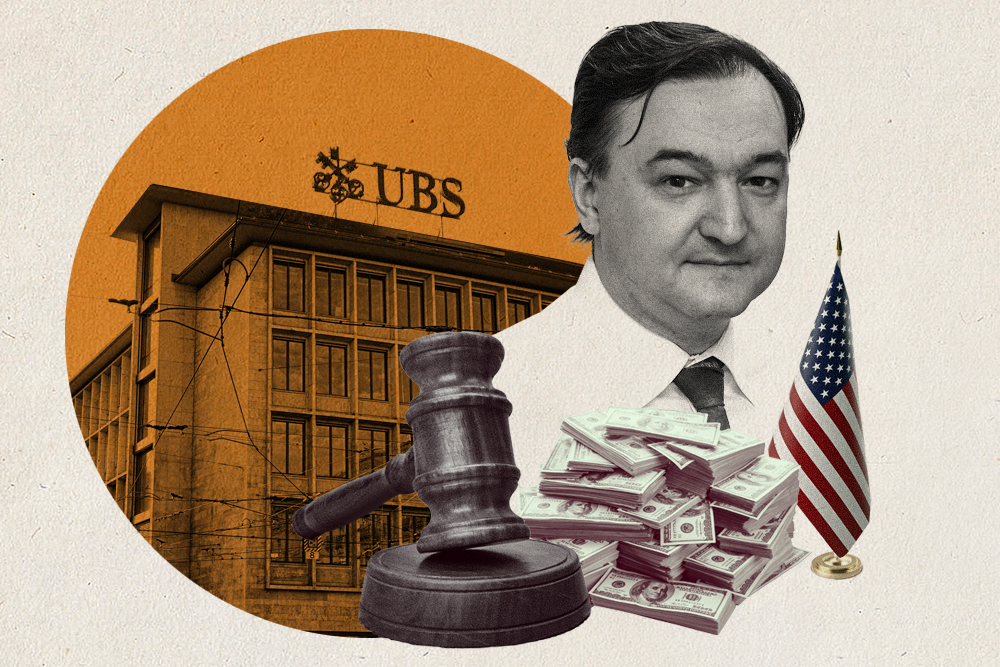







Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.