Le Paradis de la violence

Première œuvre du jeune metteur en scène iranien Sina Ataeian Dena, «Paradise» est un film sur la violence déclinée au féminin et sur sa reproduction. Réalisé sans autorisation ni subventions, il signe le retour à Locarno du cinéma iranien et d’une génération affamée de liberté.
- A quel âge une femme peut-elle se marier?
- A six ans, avec l’accord du père.
- Qu’est-ce que doit couvrir l’hijab?
- Tout. Sauf les mains et les pieds.
- Et les chevilles?
- Aussi.
- Et le cou? Dis la vérité… Tu ne le portes pas souvent, n’est-ce-pas?
- Mais la loi ne dit pas que…
- Si, mais quel exemple donnes-tu aux petites filles!
«ParadiseLien externe», présenté pour le Concours internationalLien externe, commence plus ou moins ainsi: un dialogue entre deux jeunes femmes, une inspectrice et une maîtresse d’école. Un modus operandi qui ressemble à celui d’un interrogatoire. L’écran noir. La violence des mots exacerbée par l’absence d’images..
C’est un Iran à deux visages que nous présente le metteur en scène Sina Ataeian Dena, un pays divisé entre progressistes et conservateurs, ville et campagne, femmes et hommes.
La protagoniste du film est Hanieh, 25 ans, enseignante dans une école primaire d’une banlieue pauvre et désolée, où les fillettes sont éduquées à respecter la discipline et la morale islamique. Elevée dans une famille bourgeoise de Téhéran, elle revêt tous les matins son hijab pour s’immerger dans un monde qui ne lui appartient pas, mais dont, d’une certaine manière, elle s’est rendue complice. «Qui combat les monstres devrait rester attentif, en le faisant, à ne pas devenir lui-même un monstre», écrivait Nietzsche.
Cet univers suburbain est également étranger à Dorna Dibaj qui, à 25 ans, en est à sa première expérience cinématographique. Pour mieux se mettre dans la peau de son personnage, Hanieh, elle a travaillé pendant un an comme volontaire dans une école pour filles dans la périphérie. «Je n’avais jamais endossé l’hijab auparavant, et je crois que dans le film, on voit un peu que je suis mal à l’aise», raconte la jeune artiste, le regard doux illuminé par de grandes lunettes colorées.

Entre fiction et réalité
Tourné sur une période de trois ans, sans autorisation ni subventions, «Paradise» est le nième pied de nez à la censure iranienne, emblème d’un cinéma qui a fait des barrières normatives un moteur de créativité. Et ce n’est peut-être pas un hasard que parmi les producteurs figure – aux côtés du metteur en scène lui-même et du jeune Amir Hamz – aussi Yousef Panahi, frère et partenaire de production de Yafar Panahi, cinéaste symbole de la contreculture condamné à une interdiction de tournage de 20 ans (qu’il a magnifiquement contournée avec «This is not a film» et «Taxi Teheran»).
«N’ayant pas l’autorisation de tourner le film, nous avons dû trouver des stratagèmes originaux pour avoir les images et les sons dont nous avions besoin sans trahir l’esprit du film. D’une certaine manière, cela nous a poussés à donner le meilleur de nous-mêmes et à exploiter au maximum le potentiel des nouvelles technologies numériques. Certaines images ont été de fait reconstruites et réélaborées», indique le producteur Amir Hamz.
Toutefois, «Paradise» n’est pas seulement un long-métrage de fiction. Pour contourner la censure, le metteur en scène a fait semblant de tourner un documentaire dans les écoles de banlieue. Certaines images du film sont donc en quelque sorte authentiques, comme ces fillettes en file indienne qui chantent les louanges d’Allah en battant des mains au-dessus de leur tête ou la directrice faisant son sermon du matin contre le vernis à ongles ou les élèves qui s’obstinent à vouloir jouer au football.

De même, les scènes montrant Dorna Dibaj en maîtresse d’école ont été tournées dans la classe dans laquelle elle a travaillé pendant un an, puis réélaborées à l’ordinateur. «Lorsque j’enseignais, j’allais moi aussi me cacher aux toilettes pour fumer, comme la protagoniste».
Une violence intrinsèque
Centré autour de la figure de la femme, le film «Paradise» ne se veut pas féministe, déclare Sina Ataeian Dena. «C’est un film sur la violence qui afflige l’être humain, conçu comme la première partie d’une trilogie. La condition de la femme en Iran m’a paru être une des faces les plus emblématiques de cette violence qui semble parfois être intrinsèque, comme un fantôme qui poursuit chacun de nous».
Dans le film, la violence n’a pas besoin de figures masculines particulières pour se manifester, tellement elle a été assimilée. «Les femmes en Iran se perçoivent comme des victimes, mais sans s’en rendre compte, elles reproduisent cette violence dans leur vie quotidienne. C’est comme un cercle vicieux qu’il est difficile de briser», explique le metteur en scène. «Nous faisons tous les jours l’expérience de cette violence, parfois sans nous en rendre compte», renchérit Dorna Dibaj. La société iranienne est une société de genre, où les hommes et les femmes sont séparés par une frontière plus ou moins invisible, comme dans les bus.
Avec des images poétiques et des compositions élégantes, Sina Ataeian Dena porte à l’écran une violence qui, avec des tonalités et des couleurs différentes, est en quelque sorte universelle. Mais il raconte aussi la soif de liberté d’une génération de jeunes qui, dans le film, trouve son point culminant dans la scène où les élèves de Hanieh dansent et chantent à tue-tête, cachées des regards indiscrets. Un petit acte de rébellion qui montre que l’Iran de Sina, Dorna et Amir n’est pas celui de l’obscurantisme.

L’autre face de l’Iran
Assis à la terrasse d’un bar de la Piazza Grande à Locarno, les trois jeunes ne se lassent pas de répéter que leur pays a deux visages, loin des stéréotypes véhiculés par les médias occidentaux. Car l’Iran, trop longtemps, a été associé à la figure controversée de Mahmoud Ahmadinejad, à son programme nucléaire, à la propagande anti-américaine et à la rigueur religieuse.
«Mon film ne se veut pas représentatif de la société iranienne. Mais c’est un appel à réfléchir sur la reproduction de la violence et sur la responsabilité que nous avons face aux enfants, qui représentent l’avenir d’un pays», affirme Sina Ataeian Dena.
Il est difficile de prévoir quelle voie prendra l’Iran après l’accord sur le nucléaire, et si la machine censoriale relâchera son étau, si les sans-voix retrouveront la parole. Ce qui est sûr, c’est qu’avec courage et détermination, de jeunes artistes comme Sina, Dorna et Amir font avancer la société et nous tendent un miroir dans lequel nous tous sommes appelés à nous contempler.
Sina Ataeian Dena
Né en Iran en 1983, Sina Ataeian Dena étudie d’abord la physique avant de s’intéresser à la mise en scène et de s’inscrire à la Sooreh University de Téhéran.
Il commence sa carrière dans la branche des jeux vidéo en travaillant comme superviseur des effets spéciaux et scénariste.
En 2009, il réalise son premier court-métrage d’animation, «Especially Music». Ce travail l’amènera à diriger le tournage de plusieurs spots publicitaires et de dessins animés.
Filmé sans autorisation officielle du gouvernement, «Ma dar Behesht» («Paradise») est le premier volet d’une trilogie sur le thème de la violence, qui se déroule à Téhéran.
(Traduction de l’italien: Barbara Knopf)

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

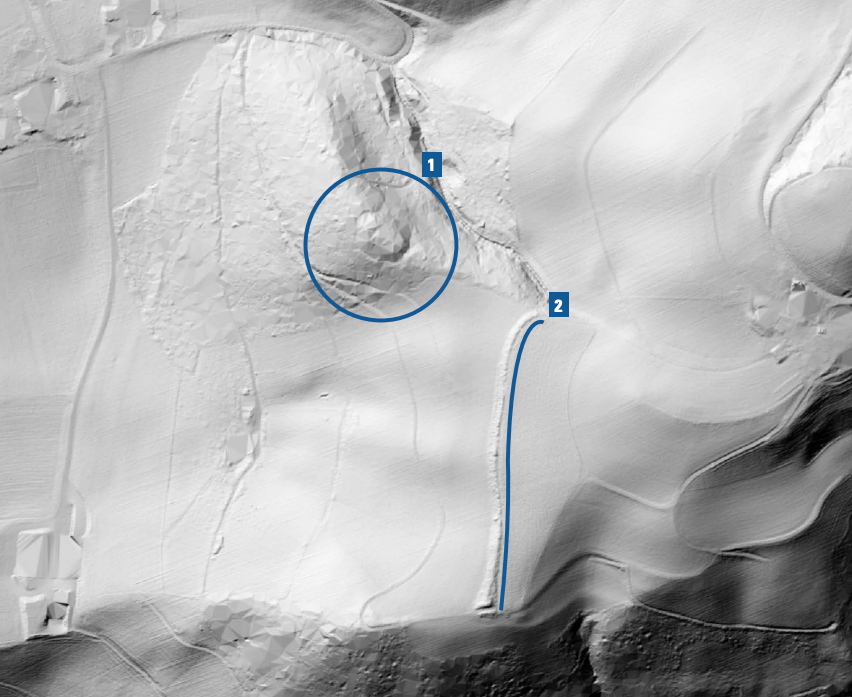












Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.