Quand les initiatives misent sur les peurs et les stéréotypes

Plusieurs initiatives populaires ont joué ces dernières années plus ou moins ouvertement la carte du bouc émissaire étranger. Faut-il dès lors limiter ce droit? Un débat qui a agité les Suisses dès le tout premier recours à cet instrument phare de la démocratie directe. C’était en 1893.
«Les bonnes âmes qui ont cru distinguer dans le nouvel article constitutionnel des tendances humanitaires et ont fait, en le votant, le jeu des antisémites, doivent reconnaitre qu’elles se sont trompées. (…) Ce n’est pas faute d’avoir été averties.»
C’est ainsi qu’un article du Journal de Genève commente l’acceptation, le 20 août 1893, par 60% des votants, d’une initiative lancée par les sociétés alémaniques pour la protection des animaux. Combattu alors par le Conseil fédéral et le Parlement, l’article constitutionnel interdisait «de saigner les animaux de boucherie sans les avoirs étourdis préalablement», soit «le mode d’abattage du bétail en usage chez les Israélites», comme le précisaient les adversaires de cette première initiative populaire de l’histoire suisse.
Dans les archives du Journal de Genève (hébergées sur le site du quotidien Le Temps), on peut lire cet avertissement d’un comité d’opposants aux «zoophiles», comme ils qualifiaient à l’époque les défenseurs des animaux: «Il ne faut pas que le droit d’initiative dont c’est aujourd’hui le premier exercice devienne un instrument d’oppression aux mains d’une race contre une autre, d’une fraction du peuple contre une autre.»
«Punir les juifs»
Comme le souligne Johanne Gurfinkiel, secrétaire général de la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD), il s’agissait pour une partie des initiants et des votants de «punir les juifs de Suisse qui étaient récemment devenus des citoyens à part entière, notamment sous la pression de la France et des Etats-Unis.»
Au début des années 2000, le Conseil fédéral a tenté d’abroger cette loi aux effets discriminatoires. Le gouvernement a fini par y renoncer pour éviter une campagne qui s’annonçait violente et discriminatoire, cette fois à l’égard des musulmans pratiquants. Comme le montrait à l’époque cette émission de Temps Présent (RTS) qui revient également sur le vote de 1893.
Initiatives xénophobes
Dans les années 1970, une série d’initiatives visant les travailleurs immigrés ont alimenté des campagnes particulièrement virulentes. À commencer par l’initiative dite Schwarzenbach, qui voulait limiter le nombre d’étrangers en Suisse. «Après des débats enflammés, elle fut rejetée de peu par le peuple en 1970», rappelle le Dictionnaire historique de la Suisse.
Durant les années 2000, les étrangers furent à nouveau l’objet de plusieurs initiatives populaires le plus souvent lancées ou soutenues par l’UDC (droite conservatrice) et contestées par les autres partis politiques. Là encore, les campagnes précédant les votations furent stigmatisantes à l’égard des étrangers, le point culminant étant atteint avec l’initiative contre la construction de nouveaux minarets, qui obtint 57,5 % des voix en novembre 2009.
Sans viser une communauté en particulier, l’article constitutionnel imposant le contingentement des étrangers adopté le 9 février 2014 témoigne aussi d’une méfiance à l’égard de l’Europe et des étrangers venant en Suisse. Ce qui a poussé le président allemand à réagir publiquement en Suisse même. Un fait peu courant.
Début avril, Joachim Gauck a tenu à souligner qu’il ne souhaitait pas et ne pouvait s’imaginer qu’un pays comme la Suisse, aussi diversifié et qui n’avait jamais connu de dictature, s’éloigne de l’Europe.
Tout en proclamant son respect du vote helvétique, Joachim Gauck a déclaré que la démocratie directe pouvait parfois constituer «un grand danger» dans des thèmes complexes sur lesquels il est difficile pour les citoyens de comprendre toutes les implications. Raison pour laquelle, selon le président, l’Allemagne était contente de sa démocratie représentative.
Ce qui a valu à Joachim Gauck la réponse suivante de son homologue suisse Didier Burkhalter: «La démocratie directe en Suisse est comme le sang dans le corps.»
Quatorze mois après son entrée en vigueur, l’article sur la révision partielle de la Constitution fédérale par voie d’initiative populaire trouva une première application avec le dépôt d’un texte visant à interdire l’abattage rituel.
Soumise au peuple sans délai, la proposition fut adoptée en août 1893, pour des motifs mêlant protection des animaux et antisémitisme.
En dépit de ce succès inaugural, le recours à l’initiative resta très rare pendant près de quarante ans. Il devint plus fréquent lors de la crise économique mondiale et surtout dans les années 1950 (questions financières, sociales et militaires), après avoir connu une éclipse pendant la guerre et l’immédiat après-guerre.
S’il décrut dans la première décennie de la formule magique, il se multiplia dès les années 1970, dans un contexte où, à gauche comme à droite, la démocratie de concordance se voyait de plus en plus critiquée.
Source: Dictionnaire historique de la Suisse
Un climat guerrier
Gare à l’arrêt cardiaque, estiment pourtant certains observateurs ou politiciens suisses, inquiets du nombre croissant d’initiatives qui jouent sur la peur et les stéréotypes, comme celle qui préconise à la fois une diminution drastique du nombre d’étrangers autorisés à s’établir en Suisse et un soutien aux programmes de planning familial pour les pays du Sud, soit l’initiative ECOPOP, soumise au vote cette année.
Ce qui amène le constitutionnaliste Andreas Auer à faire le constat suivant: «L’ambiance guerrière dans laquelle certains partis poussent nos rapports avec les étrangers m’inquiète. Il y a une recrudescence d’initiatives problématiques sous l’angle des droits de l’homme.»
Limiter le droit d’initiative?
Faut-il dès lors mettre des cautèles à la démocratie directe pour se prémunir des passions politiques et des bouffées xénophobes qu’elle permet d’exprimer?
Comme le rappelle le Dictionnaire historique de la Suisse, des voix se sont élevées dès les débuts du droits d’initiative pour signaler «les dangers d’une institution qui pourrait servir d’instrument aux mains de démagogues ou donner une influence excessive à de petits groupes bien organisés.»
Présidente de la Commission fédérale contre le racisme, Martine Brunschwig Graf rappelle en premier lieu le filtre que constitue le Parlement suisse: «Un texte raciste ou discriminatoire serait invalidé par le parlement. Des débats y ont lieu pour savoir si une initiative est contraire au droit international et aux engagements internationaux pris par la Suisse.»
Et l’ancienne parlementaire fédérale de poursuivre: «Une initiative peut montrer un climat viscéral qui ne porte pas nécessairement sur le sujet lui-même, mais sur ce que le sujet éveille chez certains. Ça existe aujourd’hui comme à l’époque. La démocratie permet d’ouvrir des débats qui ne peuvent être canalisés par des lois, si ce n’est par la norme antiraciste.»
La ratification par la Suisse de la Convention européenne des droits de l’homme (en vigueur depuis 1974) et l’adoption par le peuple, en 1994, de la norme antiraciste – l’article 261bis du code pénal suisse – marquent en effet un tournant, au moins pour les défenseurs des droits humains.
Une norme antiraciste contestée
«Jusqu’en 1974, les droits fondamentaux n’étaient garantis qu’au niveau de la Constitution fédérale et des constitutions cantonales», rappelle Andreas Auer.
En ratifiant la Convention européenne des droits de l’homme, les Etats européens ont accepté de ne plus être souverains dans ce domaine. Et ce au profit de la Cour de Strasbourg. «Qu’un citoyen puisse faire un procès à son propre gouvernement dans une instance internationale, c’est un acquis extraordinaire de la protection des droits de l’homme», assure Andreas Auer.
Le parlementaire UDC Yves Nidegger, dont le parti surfe depuis des années sur la thématique des étrangers, juge, lui, superflue la norme antiraciste: «Je n’ai pas l’impression que l’article 261bis aide quoi que ce soit. Il n’est ni nécessaire, ni utile», estime l’avocat genevois.
Pour preuve, selon Yves Nidegger, le récent arrêt de la cour de Strasbourg invalidant la condamnation en Suisse du nationaliste turc Dogu Perinçek pour avoir nié l’existence du génocide arménien. Strasbourg a mis en avant le droit à la liberté d’expression, tandis que le Tribunal fédéral suisse se basait sur l’article 261bis. La Suisse a d’ailleurs décidé de faire recours contre le jugement de Strasbourg.
En attendant, Yves Nidegger ne peut s’empêcher d’ironiser: «Faut-il violer les droits de l’homme pour les protéger?» Son parti, lui, a déposé en mars une motion parlementaire pour modifier ledit article, voire le supprimer.
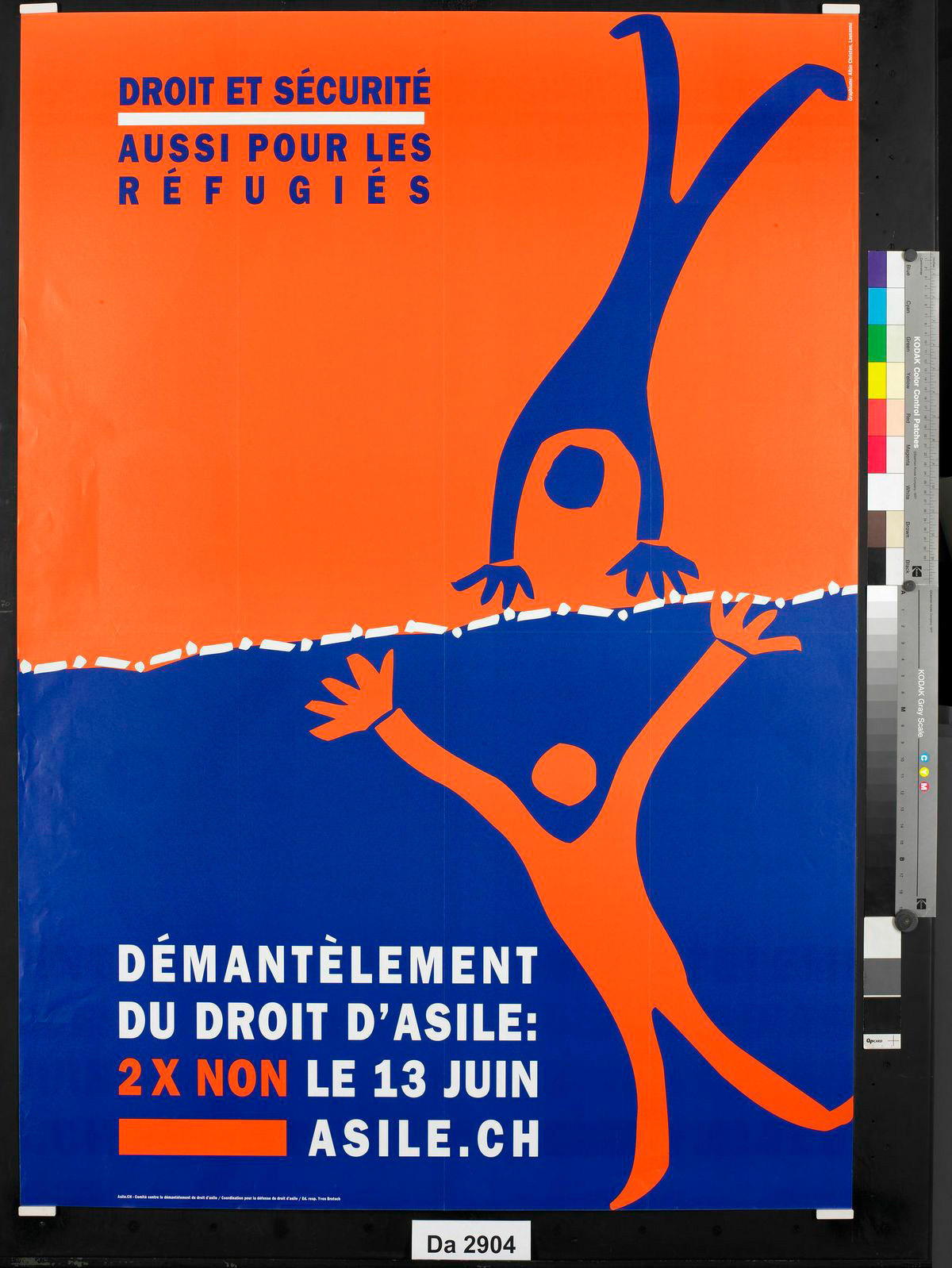
Plus
Du péril rouge à la peur des musulmans
Gare à l’arbitraire
Dans d’autres cercles politiques, certains pensent au contraire qu’après le vote du 9 février, qui a surpris l’ensemble de la classe politique, il serait bon de renforcer les conditions permettant d’exercer le droit d’initiative.
Des propositions qui laissent Andreas Auer dubitatif: «A chaque fois que la question se pose, des dizaines de propositions fusent, que ce soit au sein de l’administration, du monde politique ou académique. Mais on se heurte toujours aux mêmes obstacles. On essaye de mettre de nouvelles barrières au droit d’initiative. A supposer qu’elles passent le cap de la double majorité (du peuple et des cantons), se pose la question de savoir qui va en contrôler le respect. L’Assemblée fédérale, comme organe politique, n’est pas en mesure de le faire. Pour donner cette compétence au Tribunal fédéral, il faudrait réviser la Constitution.»
Martine Brunschwig-Graf souligne, elle, les effets pervers d’un contrôle accru du droit d’initiative: «On ne peut préventivement empêcher une initiative, sous prétexte qu’elle serait susceptible de déclencher des débats qu’on ne souhaiterait pas. On ne peut légiférer sur les intentions des gens. On tomberait alors dans un système de censure propice à l’arbitraire. Dans un système démocratique, chaque acteur (initiants, partis, élus, médias) et tous ceux qui participent à une campagne de votation ont la responsabilité de maintenir le débat dans un cadre correct.»
En d’autres termes, il ne s’agit pas de casser le thermomètre que constitue la démocratie directe, même en cas de forte fièvre parmi la population suisse.
L’article 261bis du code pénal sanctionne :
•celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse.
•celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion.
•celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part.
•celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité.
•celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public.
•sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Source : Commission fédérale contre le racisme

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative












Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.