Trois Ukrainiennes racontent leur tentative d’intégration en Suisse

Parmi les Ukrainiennes venues se réfugier en Suisse, seules 20% ont un travail. Qu’est-ce qui explique cette situation et comment se vit la recherche d’un emploi? Trois femmes, déjà rencontrées peu après leur fuite d’Ukraine, font part de leurs expériences.
Quelque 66’000 Ukrainiennes et Ukrainiens sont enregistrés en Suisse, dont près de 40’000 en âge de travailler.
Toujours selon les dernières données du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), leur taux d’emploi se monte à 20%. Un chiffre faible au regard des 70% de la moyenne suisse, et cela malgré leur bon niveau de formation.
Ce que ne montrent pas ces chiffres, ce sont les difficultés que ces personnes doivent surmonter pour obtenir un travail.
Que vivent-elles et quels sont les obstacles à franchir? Nous avons rencontré trois Ukrainiennes pour y répondre. Elles faisaient partie des cinq femmes interviewées l’an dernier, peu de temps après le début de la guerre (lire notre article de l’été 2022 ici).
Des rapports pour le WEF

Depuis son arrivée en Suisse, qui date de mars 2022, Larissa Verbitskaya, infatigable, se consacre au travail bénévole. Avant l’invasion russe, elle s’était déjà employée à aider des personnes déplacées. C’était dans le Donbass.
Un an et demi plus tard, cette femme de 54 ans arrivée de Kharkiv est toujours à Berne. Elle n’a pas perdu courage et continue à faire ce qu’elle fait le mieux: gérer des projets. Elle est intervenue comme mentor dans le cadre de deux initiatives aujourd’hui abouties, soutenant d’autres Ukrainiennes dans leurs efforts pour devenir indépendantes.
Elle a aussi participé à une équipe de vingt-cinq bénévoles qui ont distribué habits, jeux et autres marchandises à plus de trois mille Ukrainiens et Ukrainiennes.
Et en date du 24 août dernier, jour de l’indépendance ukrainienne, elle a inauguré un nouveau projet focalisé sur l’intégration. Il s’appelle «Haus Ukraine in Bern» et propose un espace destiné à l’organisation de clubs de conversation bilingue, de cours d’art, de groupes de lecture pour enfant et d’ateliers de soutien psychologique pour les aînés.
L’agenda de Larissa Verbitskaya est des plus remplis. Elle travaille quarante heures par semaine environ, pour une moitié dans le bénévolat, pour l’autre à des activités rémunérées.
Peu de temps après son arrivée en Suisse, elle a convaincu le Forum économique de Davos (WEF) de l’engager comme experte pour son «Equality Lounge». La première année, elle a reçu mandat de rédiger un rapport sur les inégalités hommes-femmes. Pour l’édition de cette année, elle prépare un document sur la situation des réfugiées et réfugiés ukrainiens.
Ses autres mandats touchent eux aussi à la question des réfugiés. Larissa Verbitskaya planche pour une fondation sur un projet international baptisé «Harmony to Ukraine», encore en phase préparatoire.
Marché du travail «plutôt hermétique»
Par le biais de son activité bénévole, Larissa Verbitskaya s’est constitué un vaste réseau. Mais «c’est dur d’être une réfugiée, personne ne choisit de l’être, confie-t-elle. En Suisse, beaucoup d’Ukrainiennes et d’Ukrainiens ont dû repartir de zéro».
Ce sentiment, elle l’a éprouvé dans sa quête d’un emploi. Une expérience qui lui a causé quelques maux de tête. «À mon avis, le marché suisse du travail est plutôt hermétique. Les employeurs préfèrent engager des Suisses ou des gens du cru.»
Larissa Verbitskaya ne fait pas mystère de sa déception et sa critique vise aussi le manque de flexibilité en matière de recrutement ainsi que le protectionnisme qui s’y applique.
«Je crois que le marché suisse du travail s’ouvre seulement aux réfugiés lorsqu’il s’agit de nettoyer les sols. Je sais nettoyer, aucun problème. Je peux aussi m’occuper de personnes âgées. Le problème est que j’ai d’autres compétences, j’ai de l’expérience et des aptitudes dans d’autres domaines. C’est pourquoi je dis aux employeurs suisses: interrogez-moi sur mon expérience.»
Juriste au mauvais endroit

Olga Zhuk, 47 ans, a, elle aussi, suivi un cursus universitaire. Elle a même deux diplômes. Le premier en physique des rayonnements, l’autre en droit.
Après l’éclatement de l’URSS, sa formation initiale ne lui a guère servi. Elle s’est réinventée en devenant avocate, pour travailler des années durant comme conseillère juridique à Kharkiv, sa ville natale.
Mais une activité dans ce domaine est difficile «sachant que la Suisse et l’Ukraine ont des systèmes juridiques différents», explique-t-elle. Ce qui l’a poussée à s’orienter vers d’autres champs professionnels.
Aujourd’hui, Olga Zhuk est toujours en quête d’emploi. «Trouver quelque chose n’est pas facile.» À ses yeux toutefois, tous les jobs n’entrent pas en ligne de compte. «Je ne veux pas être femme de ménage, j’ai toujours travaillé dans un bureau devant un ordinateur.»
L’anglais ne suffit pas
Raison pour laquelle elle fait tout son possible pour améliorer ses connaissances linguistiques: «J’ai déjà eu quelques entretiens d’embauche. On m’a dit que sans une bonne connaissance de l’allemand et du français, ce serait difficile.»
En septembre de l’an dernier, cette mère d’une fille de 23 ans et d’un fils de 21 ans a réussi à louer un grand appartement dans la commune d’Ittigen. Appartement qu’elle partage avec une amie ukrainienne et son fils adolescent.
«C’est un appartement très agréable, semblable à celui que j’avais à Kharkiv. Je suis très reconnaissante de pouvoir vivre dans un tel confort. Nous avons acheté quelques meubles et des articles de ménage. Les voisins sont très gentils même s’ils ne parlent qu’allemand. Ici, je n’ai pas vraiment besoin de l’anglais», note-t-elle en riant.
Pendant un temps, Olga Zhuk a envisagé un retour en Ukraine. Mais la situation y reste difficile. «Les prix du courant sont très élevés. La guerre dure et les gens perdent leur travail.»
Rentrer actuellement est hors de question, d’autant qu’elle dit s’être habituée à une existence sans grenades ni tirs d’artillerie. «Certains de mes amis ukrainiens, rentrés chez eux après avoir fui à l’étranger, sont ensuite retournés dans leurs pays d’accueil respectifs.»
Aujourd’hui, Olga Zhuk tente d’assurer son indépendance financière. «Je ne veux pas dépendre de l’aide sociale. […] Et si je trouve un job, je pourrai aussi payer mes impôts.»
Documentation pour les moteurs de bateaux

Darya Kaysina pour sa part ne dépend plus des prestations sociales. La jeune philologue, interprète et traductrice, a trouvé en emploi début juin.
Jusqu’à fin août 2022, elle était professeure associée au sein de son alma mater. C’est là qu’en 2018, à l’Université nationale Vassily Karazin de Kharkiv, elle avait obtenu son doctorat en philologie germanique.
Après son installation en Suisse, Darya Kaysina a continué à enseigner à distance. Mais les choses se sont compliquées. Elle a finalement décidé de ne pas renouveler son contrat.
À l’époque, elle préparait aussi un master en communication technique de l’Université de Strasbourg, entamé avant la guerre. Un cursus qu’elle a achevé avec succès en janvier dernier.
«C’est grâce au diplôme de cette université que j’ai trouvé un emploi», assure Darya Kaysina, aujourd’hui experte en communication technique chez Winterthur Gas & Diesel S.L. (WinGD), une ancienne filiale du groupe industriel Sulzer.
«Je suis chargée de tenir à jour la documentation technique en matière de moteurs de bateaux. […] Il s’agit d’une entreprise tournée vers les marchés étrangers. De fait, les moteurs de bateaux ne sont pas tellement utilisés en Suisse», plaisante-t-elle.
Un statut qui reste incertain
À 28 ans, Darya Kaysina a déjà trois masters en poche, puisqu’elle a aussi étudié la philologie anglaise et obtenu un diplôme de traductrice et d’interprète. Sa recherche d’emploi a été intensive, mais brève. Seulement trois mois.
Les langues nationales, selon elle aussi, sont l’obstacle principal. Mais il s’agit aussi de s’adapter à une culture de travail différente. Il est normal en Suisse de ne pas obtenir de réaction à une postulation. «Cette absence de réponse déstabilise beaucoup de gens, ne sachant pas si c’est oui ou si c’est non. Il est donc important de se montrer persévérant et de continuer à se battre.»
Darya Kaysina vit aujourd’hui avec sa mère dans l’agglomération de Berne et habite un appartement de location.
Au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, soulagée de ne plus avoir à s’adresser à l’aide sociale, voilà qui lui a donné plus de sécurité. Elle a en plus la chance de pouvoir travailler à distance régulièrement, ce qui lui évite les trois heures minimum de train Berne-Winterthour et retour.
«Il est clair que j’aimerais bien déménager sur mon lieu de travail, ce qui nécessitera encore quelques démarches», explique-t-elle. Déménager d’un canton à un autre n’est pas chose aisée, surtout avec un membre de la famille qui dépend encore de l’aide sociale. Les réfugiés au bénéfice d’un statut de protection ont besoin d’une autorisation cantonale.
Reconnaissante des possibilités offertes par ce statut, elle ne cache pas toutefois son inquiétude. «Je ressens toujours cette grande incertitude quant à mon statut juridique. Je ne suis pas à l’aise avec cette situation, je me rends compte qu’il court sur une période plutôt réduite.»
Traduit de l’allemand par Pierre-François Besson

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

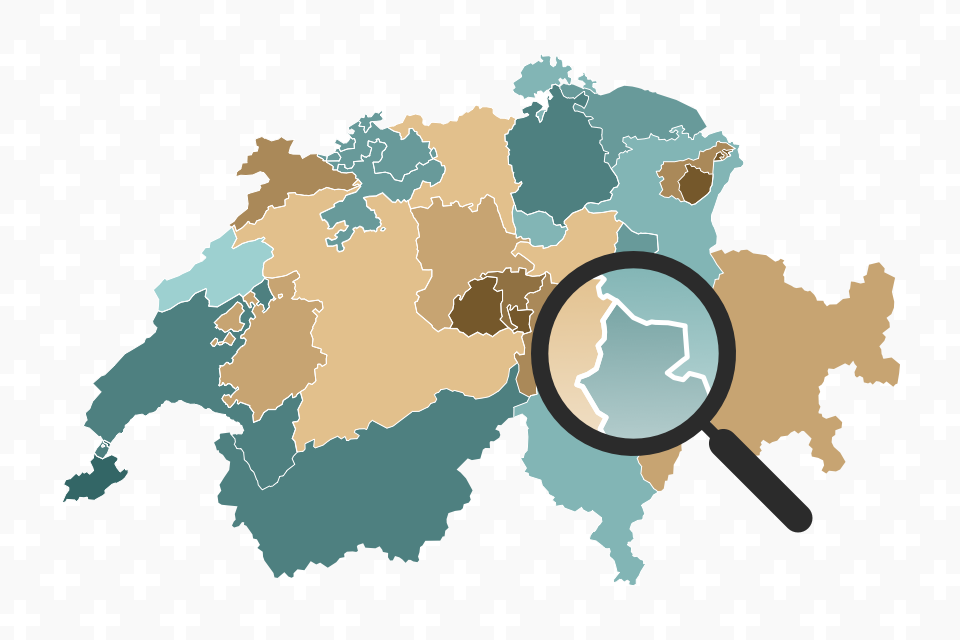

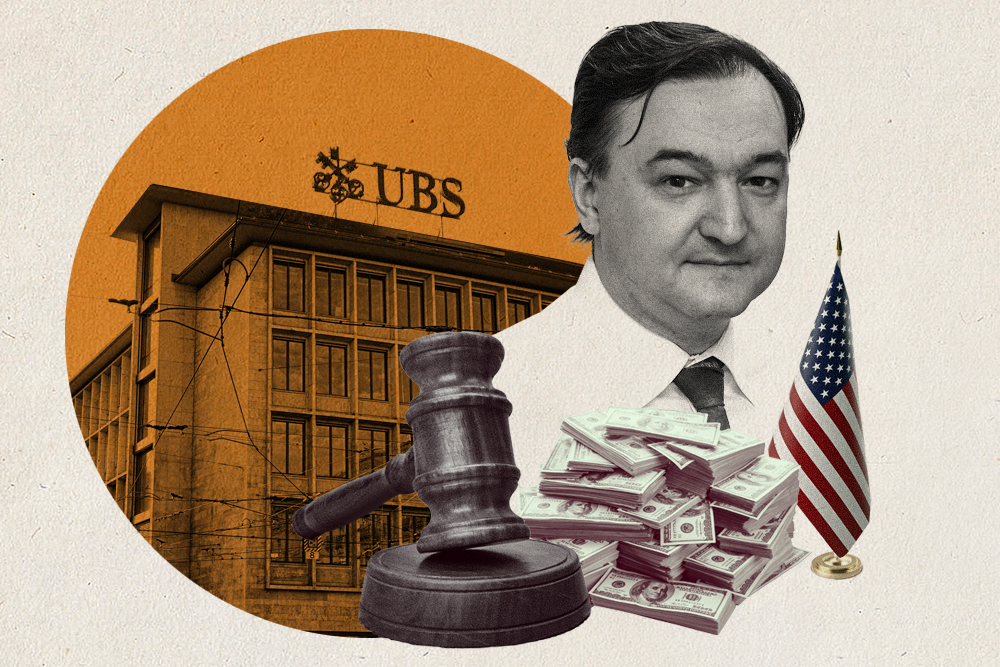










Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.