Un ingénieur suisse dans la vallée du Hezbollah

Lucas Beck travaille sur un projet de fourniture et de traitement d’eau dans la plaine de la Bekaa. swissinfo.ch a accompagné l’ingénieur suisse en mission. Une histoire de zones rouges, de chlore, et d’art de vivre à la libanaise.

Plus
Un corps de milice au service du monde
Cet ingénieur formé à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich vit depuis deux ans au Liban. Il est spécialisé dans la gestion de l’eau et des conflits. A 44 ans, son travail l’a déjà mené dans des endroits comme le Soudan du Sud, le Rwanda ou Haïti. «En comparaison, c’est plutôt détendu ici», sourit-il. Lucas BeckLien externe dirige un projet de la DDCLien externe, l’agence publique suisse pour la coopération au développement, en partenariat avec l’Etablissement des eaux de la Bekaa (BWELien externe), une branche du Ministère libanais de l’énergie.
La Suisse soutient les autorités locales dans les domaines du management et de la qualité de l’eau potable et du traitement des eaux usées. Ce projetLien externe de trois ans – un des douze en cours dans le pays – est financé à hauteur de quatre millions de francs suisses. Les plus grands défis sont le manque d’infrastructures et le grand nombre de réfugiés syriens dans la région.
Lucas Beck se rend tous les jours dans la fertile plaine de la Bekaa, qui s’étend à l’est du pays. Ici, on cultive la vigne et les légumes, et aussi – illégalement – le cannabis. La population est estimée à environ un demi-million d’habitants, faute de chiffre plus précis, puisque le dernier recensement national remonte à 1932. La région est aussi un bastion du Hezbollah chiite, à la fois milice, parti et institution sociale, qui jouit d’un solide soutien dans la population.

Comme dans le reste du pays, les infrastructures ici sont dans un triste état. Même les habitants des quartiers chics de Beyrouth auraient des coupures de courant tous les jours sans leurs générateurs. Et les poubelles dans les toilettes servent à recueillir le papier qu’il ne faut pas jeter dans la cuvette, au risque de boucher les canalisations.
Mais à Qaraoun, les réfugiés syriensLien externe ont des problèmes autrement plus sérieux. Ils n’ont pas de vrai statut, le Liban n’ayant jamais signé la convention de l’ONU sur les réfugiés. Ils sont nombreux à vivre dans de petits campements inofficiels, nommés ici ITS, pour «Informal Tented Settlements». Selon les estimations, il y aurait dans le pays environ quatre millions de Libanais, un demi-million de réfugiés palestiniens de longue date et un million et demi de Syriens – dont beaucoup travaillaient ici dans l’agriculture avant qu’éclate la guerre civile en 2011. Dans les ITS, on manque de services de base, et ce sont les ONG et les programmes d’aide qui essaient de fournir le minimum vital.
Ceux qui s’en sortent «plutôt bien»
Il pleut à verse sur la route de Qaraoun. «Nous aurions dû prendre les bottes en caoutchouc, grommelle Lucas Beck. Le temps est devenu fou. Normalement, il fait déjà bien chaud ici au début mai». Comme si l’hiver – toujours froid ici – n’était pas encore vraiment terminé.

«Nous nous en sortons relativement bien», admet Mohamed. Il habite dans un camp de quelques dizaines de tentes, alignées comme des pavillons de banlieue: une sorte de véranda sur le devant et un jardin clos à l’arrière, avec des citernes d’eau. De la lessive pend devant les portes. On dirait presque un quartier de village, au milieu des champs. Le Syrien préfère ne pas donner son vrai nom et ne veut pas apparaître en photo, il a peur de la tourmente qui règne dans son pays natal, qui n’est qu’à quelques dizaines de kilomètres à l’est. «Nous sommes ici depuis cinq ans et demi», dit sa femme Zayneb, qui ne peut pas décemment nous laisser sur le seuil et nous invite à entrer – l’hospitalité d’abord.
Cette famille de quatre personnes vit dans deux pièces. En découpant des figures dans des restes de papier brillant, Zayneb a décoré avec amour les murs du salon. Ils touchent 20 dollars par personne et par mois. Ils ont eu de la chance, explique son mari. «Nous n’avons presque pas de problèmes avec la commune et les Libanais d’ici ne nous en posent pas davantage – nous nous laissons mutuellement en paix». Ce qui ne va pas forcément de soi. Le ressentiment croît dans la population envers les réfugiés syriens. Il est alimenté par les clivages politiques, mais se fonde aussi sur la longue présence de forces syriennes au Liban, qui étaient encore là il y a un peu plus de dix ans.
«Le plus important, c’est que les enfants puissent aller à l’école ici. Et nous avons de l’eau», dit Mohamed. En effet, elle coule d’un tuyau dans la cuisine et une annexe abrite des latrines.
«Ici, l’eau est pompée illégalement du réseau public, explique Lucas Beck. Les communes ferment souvent les yeux, et parfois, elles ferment le robinet pour quelques jours. L’alternative, c’est de se faire livrer par des privés, payés par des ONG, mais c’est cher».

L’Etablissement des eaux de la Bekaa manque d’argent. C’est qu’une grande partie des ménages locaux ne paye pas non plus son eau. «Certains ne peuvent pas se le permettre. D’autres n’ont pas confiance dans les institutions étatiques – les gens se sont habitués à ce que beaucoup de choses ne fonctionnent pas correctement. Alors, ils se demandent: pourquoi devrais-je payer?», note Lucas Beck.

L’équipe a installé des compteurs sur les canalisations du camp de tentes. Ils sont relevés chaque semaine. «C’est une petite mesure. Cela nous donne une vue d’ensemble de la consommation, une base sur laquelle on peut travailler», explique l’expert suisse, pragmatique. Il veut savoir combien l’Etat perd. Il n’a pas le syndrome du sauveur, et il n’est pas davantage un bureaucrate – cela se voit, c’est sur le terrain qu’il est à l’aise: «Le contact direct avec la population locale et avec les collègues est important pour moi. Beaucoup d’ONG s’installent dans des bureaux à Beyrouth, viennent ici, font quelque chose, puis repartent».
« Il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Mais en tous les cas, l’hospitalité des gens n’en est pas un »
Il est ici comme expert technique, mais il est aussi un peu diplomate. Dans le quartier où il habite à Beyrouth, on le connaît, on le salue, ici par un «hi!», là par un «kifak?» – «comment ça va?» Son cercle d’amis comprend de nombreux Libanais, ce qui est plutôt inhabituel chez les expats. «Il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Mais en tous les cas, l’hospitalité des gens n’en est pas un», dit-il. D’abord plutôt direct, Lucas Beck rit facilement, beaucoup et fort. Il y dû apprendre l’art de la conversation légère à la libanaise. Car ici, mieux vaut éviter de mettre les pieds dans le plat.
De la politique et des poulets
La négociation aussi est tout un art au Liban, avec des rituels à respecter. Comme lors de cette rencontre avec Dr. Nassar, président de l’association des communes de Baalbek ouest. Dans son bureau, on boit le thé sucré, et on commence par une demi-heure à parler de tout et de rien. Puis, on nous sert du poulet. L’objection que l’on a déjà mangé n’est pas recevable. «C’est la manière de Baalbek», sourit notre hôte.
Lucas Beck et sa collaboratrice Darine Saliba sont venus demander le feu vert pour un projet. Il s’agit de lier protection de la nature et tourisme et de promouvoir le dialogue dans la région. Pas facile, la région autour de la ville est une zone politiquement sensible. Beaucoup de chiites, peu de chrétiens, et une petite minorité sunnite. La carte confessionnelle est compliquée partout au Liban, pays aux 18 communautés religieuses reconnues.
Verte, jaune, rouge: un pays plein de zones
Dans la Bekaa, les rapports de force changent d’un village à l’autre. La structure politico-confessionnelle est basée sur les clans familiaux. Certains appellent ça la mafia libanaise, d’autres disent que sans appui, on ne va pas loin dans ce pays.
« J’aime le côté direct des Suisses »
Qui prête allégeance à qui, qu’est ce qui est important dans quel village, à quoi ressemblent les alliances et quels sont les sujets qu’il vaut mieux éviter d’aborder, Darine Saliba sait tout cela par cœur. Enfant de Zahlé, cette travailleuse sociale connaît bien la Bekaa de l’intérieur. Avant, elle s’occupait de réfugiés et de prisonniers irakiens. Depuis une année et demi, elle travaille avec les Suisses, qu’elle aide aussi à surmonter l’obstacle des langues. Qu’est-ce que cela fait d’avoir un chef suisse? «J’aime leur côté direct. On sait où on en est. Les Libanais accordent beaucoup plus d’importance à la courtoisie – si on est en colère, on ne va pas le montrer».

Sur la route de Baalkbek à Chamsine via Aanjar, cette jeune femme d’une vingtaine d’années me donne une rapide leçon sur le paysage politique de la Bekaa. Le Liban est divisé en zones: verte, jaune, rouge. Beyrouth est en zone verte, réputée sûre, à l’exception de certains quartiers. En zone jaune, il convient d’être plus prudent, et la zone rouge est déconseillée aux voyageurs. Pratiquement aucun étranger ne s’y aventure. Et pourtant, il y a là des sites antiques fascinants, et les paysages sont magnifiques. Quand Lucas Beck et son équipe se rendent dans certains endroits, ils communiquent leur position par SMS à l’ambassade suisse à Beyrouth – par mesure de sécurité.
Nous atteignons Chamsine, à côté de la ville d’Aanjar, à la population majoritairement d’origine arménienne. La campagne est très verte, le village dispose d’une source et d’une station de pompage privée, qui travaille pour l’Etablissement des eaux de la Bekaa. «Ici, nous ajoutons du chlore à l’eau qui est pompée, afin qu’elle soit potable», explique Lucas Beck.

Plus
La source de Chamsine
Les Suisses n’installent pas eux-mêmes les systèmes de traitement des eaux claires et des eaux usées. Une grande partie du travail de ses cinq membres consiste à former les employés locaux, à permettre le dialogue, à trouver des coopérations, à mettre en place des processus de contrôle et à faciliter le travail des spécialistes locaux. Ainsi, l’équipe a installé à Zahlé un petit laboratoire qui sert à mesurer les valeurs des eaux usées.
Et après les trois ans?
C’est un travail de longue haleine. «Il faut de la patience, dit l’ingénieur. On ne peut pas changer complètement le système. On doit donc travailler à petite échelle». Et le budget – quatre millions de francs suisses sur trois ans – est plutôt mince. Malgré cela, il préfère cette approche que celle d’aller n’importe où dans le monde et de construire des installations coûteuses que plus personne ne saura entretenir après le départ des coopérants. «J’essaye de travailler avec les moyens que nous avons sur place».
« On ne peut pas changer complètement le système »
Ce qu’il veut, c’est établir des structures durables. «C’est comme ça que je comprends la coopération au développement. Et cela a aussi beaucoup à faire avec la prévention des conflits». Le mandat de Lucas Beck se termine au printemps 2019. Et après? Il réfléchit: «Je ne sais pas. Je me plais déjà ici, mais d’un autre côté, il y a d’autres endroits et d’autres projets passionnants dans ce monde». Et de répondre presque à la manière libanaise: «On verra…»
Disclaimer Au vu de la situation sécuritaire dans les zones de reportage, l’auteure a été en permanence accompagnée par l’équipe du bureau suisse de la coopération et a suivi le briefing de sécurité officiel de l’ambassade suisse à Beyrouth. Les coûts du voyage ont été pris en charge par swissinfo.ch.
Collaboration: Helen James, Kai Reusser, Julie Hunt
Contactez l’auteure sur Twitter: @marguerite_jayLien externe
(Adaptation de l’allemand: Marc-André Miserez)

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative














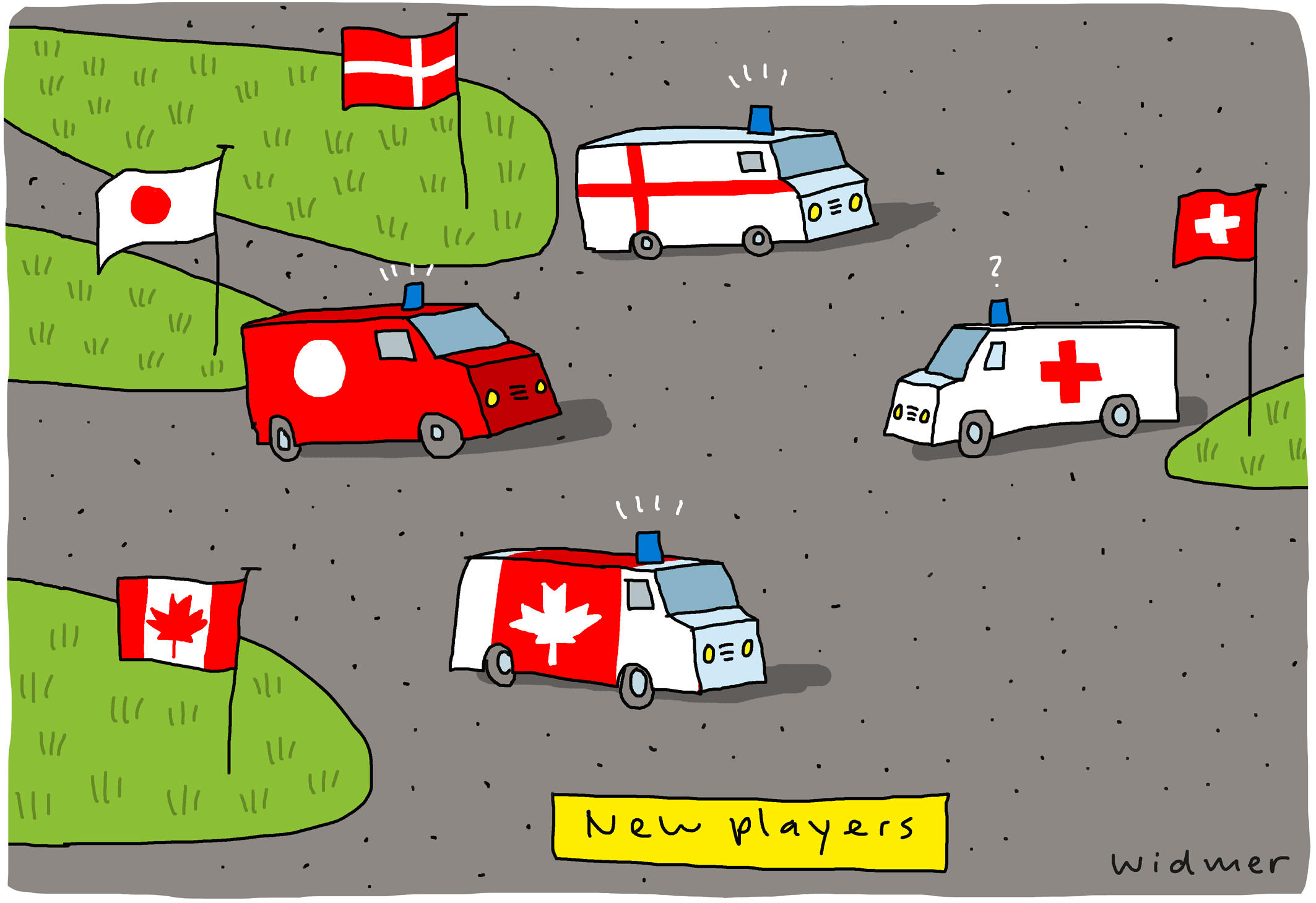
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.