Un vétéran brésilien des droits de l’homme est une cible dans son pays

Paulo Sérgio Pinheiro célèbre ses 25 ans de service au sein des Nations unies. Au cours de ce quart de siècle, il a occupé plusieurs postes de haut niveau dans le monde entier, une grande partie de son travail étant axée sur les violations des droits de l’homme. Pourtant, c’est dans son pays natal, le Brésil, qu’il doit fait face à sa plus grande menace. Interview.
Le juriste Paulo Sérgio Pinheiro a récemment été mis sur une liste d’enseignants, de policiers et de personnalités publiques que le gouvernement et les services de renseignements brésiliens considèrent comme des «antifascistes».
Dans une interview accordée à swissinfo.ch, Paulo Sérgio Pinheiro s’exprime sur les défis rencontrés durant sa carrière, le multilatéralisme, le rôle central des victimes dans les travaux de l’ONU et le fait d’être devenu une cible politique au Brésil.
swissinfo.ch: Après 25 ans passés au service de l’ONU, quel rôle pensez-vous que cette organisation internationale puisse réellement jouer pour protéger les droits de l’homme?
Paulo Sérgio Pinheiro: Si l’on considère les Nations unies dans leur ensemble, les droits de l’homme ont été dès le tout début au cœur de l’organisation, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Ils sont présents dans les décisions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Toutes les agences onusiennes protègent les droits de l’homme dans le monde entier. Mais l’organe le plus important qui assure cette fonction est le Conseil des droits de l’homme des Nations unies à Genève, dont les rapporteurs spéciaux en place depuis 1979 examinent la situation des droits de l’homme dans différents pays, avec l’aide du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme.
Avez-vous éprouvé des frustrations en raison des limites du rôle international?
Seules les victimes – que je préfère appeler survivants – de violations des droits de l’homme peuvent ressentir de la frustration. Ceux d’entre nous qui tentent de mettre en lumière les violations des droits et de demander justice ne sont frustrés que par les organes des Nations unies qui ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Après plus de dix ans de violations des droits de l’homme et de crimes de guerre, en Syrie par exemple, le dysfonctionnement du Conseil de sécurité fait que ces crimes ne sont pas jugés par la Cour pénale internationale. C’est non seulement frustrant, mais aussi inexplicable pour les survivants de la guerre.
Au Burundi, lors de votre première mission en 1995, on attendait vraiment que des progrès soient réalisés. Cela a-t-il fonctionné?
Le rapporteur spécial n’a pas de baguette magique pour changer la situation dans un pays particulier. Mais la différence réside dans le fait qu’il y a eu des rapporteurs spéciaux et, après 2016, une commission d’enquête. La société civile locale est plus forte, et le gouvernement se sent habilité dans le domaine des droits de l’homme. Mon meilleur interlocuteur était le ministre des droits de l’homme, Eugène Nindorera, qui est devenu plus tard directeur des droits de l’homme des Nations unies pour les missions en Côte d’Ivoire et au Sud-Soudan.
Vous avez également passé des années à traiter avec le Myanmar et sa dirigeante, Aung San Suu Kii, alors qu’elle était encore assignée à résidence. À quoi ressemblaient ces réunions?

Le Myanmar est un cas exceptionnel, car il s’agissait d’un gouvernement militaire qui souhaitait se rapprocher des organes des Nations unies chargés des droits de l’homme et de la société civile. Pendant les quatre premières années, j’ai eu accès à tous les lieux et institutions que je souhaitais. Mais ni moi ni les autres représentants des Nations unies dans le pays n’avons répondu de manière satisfaisante à cette ouverture. Le gouvernement n’a donc pas pu justifier notre présence auprès de la junte militaire qui dirigeait effectivement le pays et a finalement été évincée. Je n’y suis retourné que quatre ans plus tard, en 2007, lorsqu’il y a eu un soulèvement des moines bouddhistes et de la société civile.
La guerre en Syrie dure maintenant depuis près de dix ans et l’enquête que vous menez a permis de recueillir une quantité d’informations sans précédent sur la crise. Que pouvez-vous faire avec ces informations?
La Commission internationale indépendante d’enquête sur la République arabe syrienne n’est pas un tribunal, et elle n’a aucune compétence en matière de négociations politiques. L’objectif est d’enquêter et de documenter les violations des droits de l’homme, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Nous travaillons pour répondre au droit à la vérité du peuple syrien.
Notre base de données a été utilisée dans le cadre d’enquêtes ouvertes dans plusieurs pays sur les auteurs de violations des droits de l’homme dans le cadre de ce conflit. Nos données ont également été utilisées par le Mécanisme international impartial et indépendant sur la Syrie, qui prépare des affaires pénales qui seront portées devant les tribunaux à l’avenir.
2020 marque également le 75e anniversaire de l’ONU. Qu’y a-t-il à célébrer?
Il y a plus à commémorer qu’à regretter. Imaginons que l’ONU n’existe pas. Les conflits internationaux seraient beaucoup plus intenses, les crises humanitaires ne seraient pas abordées et les droits économiques et sociaux seraient encore moins garantis. Et l’application, même imparfaite, des principes de la Déclaration universelle et des conventions sur les droits de l’homme serait encore moins efficace. Mon assistante lorsque je travaillais au Burundi, Brigitte Lacroix, m’a dit à son départ: «Ce qui compte vraiment, c’est ce que tu vas faire pour les victimes. Du point de vue des survivants, nous devons nous réjouir, car ils sont au centre de nos actions».
L’ONU et le multilatéralisme sont à la croisée des chemins, et la réponse à la pandémie le montre. Y a-t-il un risque réel pour le système?
La pandémie a clairement mis en évidence l’inégalité, la concentration des revenus et le racisme qui continuent à prévaloir dans presque toutes les sociétés, au Nord comme au Sud. Personne n’y a échappé. Ceux qui étaient pauvres le deviennent plus encore; la situation des pauvres en matière de santé a empiré, non seulement en raison du manque de soins pour les personnes touchées par le coronavirus, mais aussi en raison du droit aux soins de santé en général.
Je ne pense pas qu’après la pandémie, il y aura automatiquement une plus grande solidarité ou une meilleure prise en charge des personnes privées de leurs droits. Pour cela, les États membres de l’ONU, au lieu de refuser des ressources au système – comme ils l’ont fait avec l’Organisation mondiale de la santé – doivent augmenter leur soutien politique et leurs ressources financières à l’ONU.
Votre citoyenneté brésilienne vous a-t-elle aidé dans votre travail international au cours des 25 dernières années?
L’Amérique latine, comme le dit un ancien ambassadeur de France au Brésil, Alain Rouquié, dans un de ses livres, est le Far West, une catégorie à part du monde occidental. Parce qu’ils font partie de ce groupe, les Brésiliens sont perçus comme étant indépendants. Après le retour à la démocratie en 1985 et jusqu’à l’administration de Dilma Rousseff, en 2016, le Brésil était considéré comme un honnête courtier – un négociateur fiable. Parce que pendant cette période, nous n’avons jamais nié les graves violations des droits de l’homme au Brésil. Tous les pays voulaient figurer sur la photo avec le Brésil – jusqu’au coup d’État contre la présidente Dilma Rousseff. Au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, le Brésil a toujours été présent pour les résolutions les plus sensibles, comme celles sur l’homosexualité, le racisme et la violence contre les femmes et les enfants. Je pense que l’aura du Brésil m’a certainement été bénéfique.
Vous avez été inclus dans une liste de soi-disant «antifascistes» préparée par le ministère brésilien de la Justice cet été. C’est une espèce de dossier contre ceux qui questionnent le gouvernement. Comment le percevez-vous?
C’était un étrange honneur d’avoir été inclus sur cette liste, alors qu’il aurait suffi d’ouvrir Google pour voir ce que je pense, dis et fais au Brésil, dans les organes des Nations unies et dans le monde entier. Il s’agissait d’une initiative regrettable visant à ressusciter les odieux dossiers d’espionnage politique de la dictature militaire.
Heureusement, la Cour suprême fédérale a pris la décision historique – lors d’un vote à 9 contre 1, le 21 août – d’interdire au ministère de la Justice de diffuser ces rapports sur ce que pensent et font certains citoyens.

(Traduction du portugais: Olivier Pauchard)

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

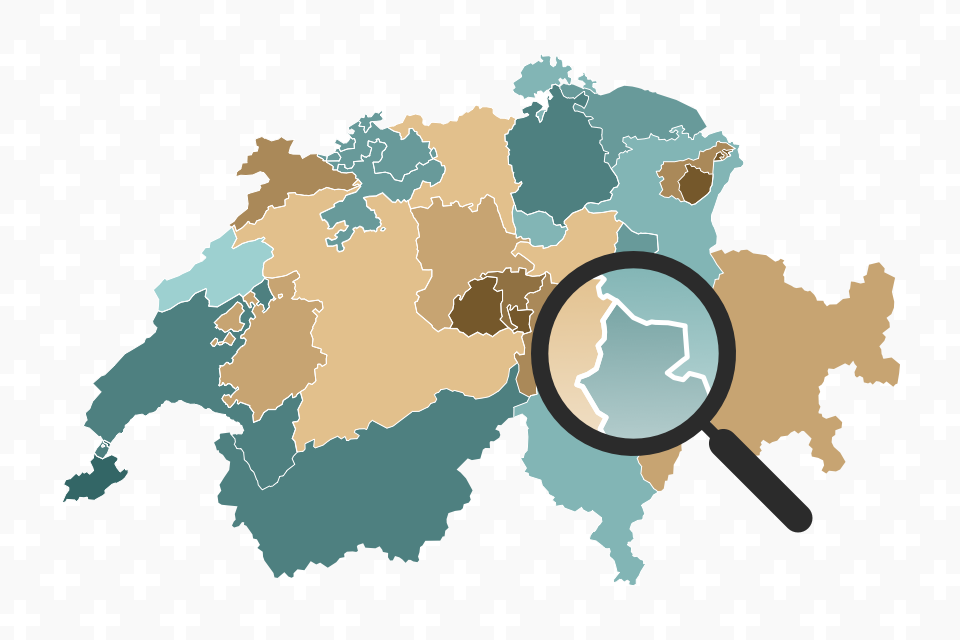

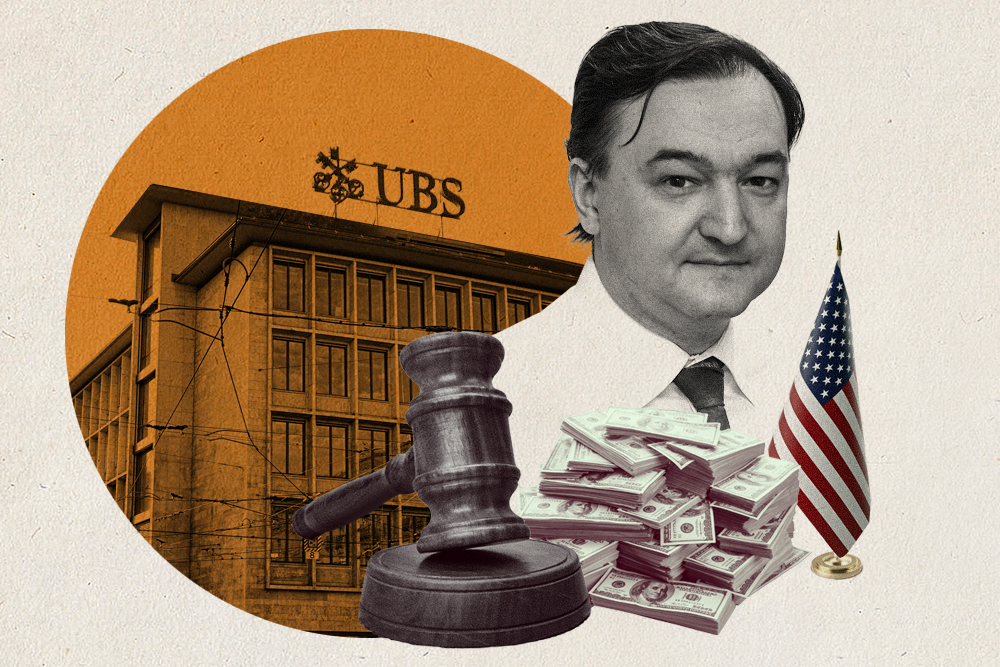










Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.