Le dilemme des humanitaires, entre sécurité et efficacité

Les organisations humanitaires tentent de trouver la parade face aux nombreuses attaques visant leurs personnels sur le terrain. Un difficile équilibre entre sécurité et efficacité.
Syrie, Irak, Libye, Ukraine: en 2014, les travailleurs humanitaires ont à nouveau payé un lourd tribut dans l’accomplissement de leur mission, avec des cas qui ont particulièrement choqué comme l’exécution de l’otage américain Peter Kassig par les djihadistes de l’Etat islamique en Syrie.
«La sécurité nous préoccupe beaucoup», reconnaît Peter Staudacher, de Caritas Suisse, organisation active dans plusieurs pays sinistrés ou en guerre. Selon lui, «la réalisation de projets et la sécurité des humanitaires dans les zones de conflits nécessitent une planification et un budget spéciaux».
Même écho du côté de Terre des hommes, organisation qui assure des services humanitaires aux Syriens et Irakiens réfugiés au Liban, en Jordanie et au Kurdistan (nord de l’Irak). A ce sujet, Zélie Schaller, chargée des relations médias, affirme : «En matière de sécurité, nous prenons des mesures qui nous permettent d’éviter les dommages aussi bien intentionnels qu’accidentels. Cette politique ne conduit pas forcément à l’élimination de tout danger, mais grâce à elle nous pouvons évaluer la situation sur le terrain, pour chacune de nos missions, et établir un plan sécuritaire destiné à protéger nos travailleurs».
Le CICR (Comité international de la Croix-Rouge), actif dans plus de 80 pays pour aider les victimes de conflits armés, renforcer le respect du droit humanitaires ou visiter les prisonniers et faire valoir leurs droits, affronte lui aussi le défi sécuritaire. Sa porte-parole, Dibeh Fakhr, reconnaît : «Aujourd’hui, en Syrie, en Irak ou en Libye, les problèmes liés à la sécurité sont nombreux, ils concernent beaucoup de gens».
Une équation difficile
Il faut dire que dans le domaine humanitaire, assurer la protection des individus relève d’un exercice d’équilibriste.
Protéger sans perdre de vue le résultat souhaité constitue en effet une équation difficile à résoudre. Celle-ci exige un calcul délicat permettant d’assurer la sécurité des humanitaires sans compromettre pour autant l’efficacité de leur travail sur le terrain. Peter Staudacher le sait. Il précise : «Il ne faut pas chercher à réaliser sur le terrain, coûte que coûte, l’objectif que l’on s’est fixé; ce qui compte, c’est une évaluation constante de la situation permettant de faire le tri entre ce qui est nécessaire et ce qui l’est moins».
Respecter l’équilibre entre sécurité et efficacité n’est pas aisé, reconnaît, de son côté, Dibeh Fakhr. «Parler avec toutes les parties au conflit nous demande parfois beaucoup de temps et exige des négociations difficiles. Nous sommes souvent obligés de nous contenter d’un minimum de garanties si nous voulons secourir ceux qui ont besoin de nous». Elle ajoute : «Il existe aujourd’hui plusieurs régions auxquelles nous n’avons pas accès faute d’autorisation. Plus problématique : nous ne disposons pas de notre liberté pour agir par nous-mêmes».
Se défaire de ses signes distinctifs?
Construire des murs surmontés de barbelés ou limiter la marge de manœuvre des humanitaires peut, il est vrai, contribuer à l’établissement d’une certaine paix. Mais ces deux moyens, s’ils sont adoptés, creusent l’écart entre les organisations humanitaires et ceux qui bénéficient de leur secours.
De façon générale, une politique de dissuasion n’est acceptable que si elle est utilisée «pour sauver des vies ou acheminer une aide susceptible d’éviter une catastrophe», comme le dit Peter Staudacher. Recourir à la protection armée «pousse les habitants locaux à considérer les organisations humanitaires comme faisant partie de la même ‘barque’ conduite par les forces étrangères sur place», ajoute-t-il.
Obligées d’être discrètes, les organisations humanitaires doivent parfois se défaire de leurs signes distinctifs (logos, voitures…). Mais ce procédé peut créer une ambiguïté autour de l’identité d’une organisation et provoquer la méfiance chez les travailleurs locaux. Selon Dibeh Fakhr, il n’existe pas cependant de formule magique pouvant s’appliquer à toutes les situations difficiles, «lesquelles varient d’un pays à l’autre. Travailler en Irak, par exemple, ce n’est pas comme travailler en Libye ou au Yémen. Pour chaque pays il faut une stratégie».
Collaborer avec la population locale
Préférer l’ouverture à la force est donc le choix de Terre des hommes. «La plupart de nos employés sont originaires des pays dans lesquels nous sommes actifs. Ce choix nous permet de mieux identifier les besoins locaux, en fonction desquels nous pouvons ensuite élaborer nos projets», explique Zélie Schaller. De même, Peter Staudacher estime que la collaboration avec les collectivités locales est importante. «Il faut, néanmoins, leur éviter nos propres problèmes, dit-il, et veiller à ne pas les exposer au danger».
Le CICR essaie, lui aussi, de «s’adapter aux coutumes et méthodes de travail» du pays où il est actif, comme l’explique Dibeh Fakhr. Il faut préciser ici que l’institution collabore sur place avec ses partenaires, les organisations nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Celles-ci l’aident dans la mise en œuvre de ses projets et dans les négociations menées avec les parties au conflit.
La sécurité pose des problèmes aux humanitaires, comme on l’a vu. Mais il existe des moyens qui visent à améliorer ou renforcer l’aide aux populations dans les pays sinistrés. Parmi ces moyens, les campagnes de sensibilisation, l’écoute et le dialogue avec les habitants et les organismes locaux.
(Traduction de l’arabe: Ghania Adamo)

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
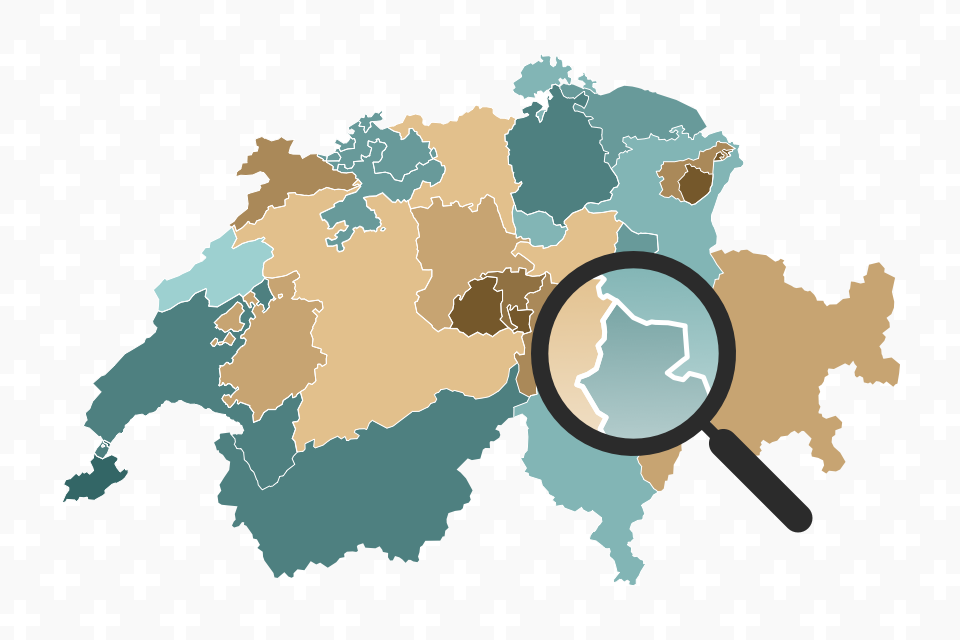










Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.